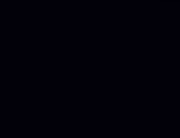« Les nouvelles de Pananme » (Editions du Lamantin) est un ouvrage écrit par des élèves de 4ème du collège Marguerite Duras établissement de Colombes (92) appartenant au Réseau d’éducation prioritaire. Les 22 textes ont été élaborés au cours d’ateliers d’écriture animés par l’écrivain Fabrice Guillet. L’objectif : rapprocher les auteurs de la réalité et montrer aux jeunes qu’ils sont capables d’écrire, quel que soit leur niveau scolaire. La preuve avec cette nouvelle de Louise Vouilloux, « Erreur d’époque ».
Tous les matins, je prends la rue qui mène à la station de métro 3, direction Gallieni. Là, je croise Fred, un vieil ami qui a ouvert son restaurant. Il me donne mon déjeuner du midi à emporter quand je viens lui dire bonjour. Puis, souvent, Barbara passe en vélo, c’est une grande écolo. Pour ne pas s’arrêter dans son élan, elle fait sonner son vélo en guise de salutation. Plus loin, je croise les deux collègues : Paul et Ahmed. Ils vont prendre un café chez Starbucks Coffee, ils ne jurent que par ce café ! Comme ils attendent souvent, je les croise et ils me font leurs signes de tête.
Ça, c’est mon quotidien, mes habitudes du matin, ça me tient très à cœur. Je suis ce genre de personne qui aime son quotidien, ses petites habitudes. Je suis loyal, sans me vanter, je suis très à cheval sur ça, comme dirait mon père : personne n’a le droit d’être volé. Je m’appelle Léon Lemanche, j’ai la trentaine et je suis célibataire. Je suis Parisien, j’habite dans le quartier de l’Opéra, employé dans une grande entreprise d’informatique avec un patron très pointilleux. Je suis totalement fan des présidents américains, pour ce qu’ils ont fait pour leur pays, et j’ai en particulier une grande admiration pour John Kennedy, assassiné au sommet de sa gloire. Ah oui, je suis aussi un vrai curieux, c’est souvent un défaut mais pas toujours… Bon ! Assez parlé, aujourd’hui, mes habitudes sont tombées à l’eau.
Bip, bip, bip… Huit heures, à mon grand étonnement, je n’étais pas en forme car la veille, insomnie de deux heures, pas de sommeil. Je regardai mon téléphone, vérifiai mes mails, mes réseaux sociaux et je me levai, me précipitai sous la douche. Après m’être préparé, je regardai l’heure et j’avais vingt minutes d’avance. Je remarquai cependant qu’un facteur avait laissé un paquet devant ma porte. Je m’avançai vers cet objet et lut : « Monsieur John Kennedy, 113 boulevard Malesherbes ».
Je crus d’abord à une blague, mais le colis avait l’air vieux. Je m’inquiétai et me demandai que faire, l’ouvrir ou me rendre à cette adresse ? Je ne savais pas, je ne savais plus quoi faire. Je m’assis puis remis mes idées en place. Jamais je n’oserais ouvrir ce paquet sans l’accord du propriétaire. Le problème, c’était qu’il était mort depuis cinquante ans !
Sans réfléchir, je regardai mon téléphone : huit heure dix. « Mince, je dois être au bureau à huit heure trente ! » me suis-je rappelé. Je ne savais toujours que faire, je partis donc de nouveau sans rien décider. Il était huit heure quinze. Je n’eus pas le temps de saluer Fred, donc pas de déjeuner. Je courus et passai devant Ahmed et Paul en leur adressant un bref signe de la main en guise de bonjour. Pas très poli mais je manquais de temps. Quant à Barbara, je ne lui prêtai aucune attention…
Installé dans le métro en direction de Levallois-Perret je tenais dans mes bras le colis tout en le fixant : comment un objet destiné à cette célébrité avait-il pu atterrir devant chez moi ? Quand même inquiétant !
Le métro tanguait, droite, gauche, droite, gauche, de légères secousses très rythmées : les gens étaient tous silencieux, l’un avec son casque, l’autre avec son bouquin et sa coupe de cheveux frisés. Quatre femmes toujours pressées avec leurs poussettes, les étudiants, les grands-parents, les touristes, les hommes d’affaires… J’aime beaucoup ce quartier.
Puis je revins à mon histoire de colis et décidai de changer pour une fois mes habitudes. J’envoyai un message à mon patron : « Je suis grippé, fièvre insupportable, cloué au lit. Je suis dans l’incapacité de venir. Merci. Léon ».
La lumière orange clignotait sur l’arrêt. Villiers, je devais descendre. Mais avec toutes ces réflexions, je m’aperçus que mon colis avait malheureusement disparu. « Mais quel idiot, me suis-je dit, pas capable de surveiller une simple boîte en carton ! ». Je poussai alors tout le monde et aperçus un grand homme avec une mallette de travail et mon paquet à la main. Je m’élançai alors à sa poursuite sans me préoccuper des gens qui m’entouraient.
La course poursuite était lancée, mais en courant, le grand homme bouscula un passant au téléphone, le colis lui échappa des mains mais, ne voulant pas montrer son visage, il s’enfuit. J’attendis de reprendre mon souffle, pris le colis et levai la tête pour regarder dans quelle rue je me situais. Je vis alors un oiseau picorer un morceau de pain qu’une dame âgée lui donnait. Je reconnus alors le parc Monceau et sur un banc, je vis mon ami Jules Rocka qui cherchait souvent son inspiration dans ce parc. Je le saluai de loin puis continuai ma route.
Je sortis par la grande et imposante porte dorée et noire puis cherchai l’adresse inscrite sur le colis. La rue se trouvait juste à ma droite. Une foule de gens allait dans les deux directions et mes épaules étaient chahutées dans tous les sens : ça allait des familles entières qui se rendaient au parc Monceau aux hommes d’affaires qui étaient pressés ou aux touristes perdus dans cette ville géante. Finalement, je réussis à arriver devant l’immeuble qui correspondait à l’adresse du colis.
Je toquai à la porte puis je sonnai. Une vielle gardienne aux cheveux bouclés se présenta. Je lui dis sans réfléchir :
– Madame Kennedy ?
– Ce n’est pas mon nom, répondit-elle d’un air moqueur.
Confus, je repris avec un air plus poli :
– Bonjour madame j’ai reçu un colis indiquant votre adresse.
– Entrez, entrez, je vous en prie, me dit-elle.
J’entrai dans ce somptueux immeuble les yeux grands ouverts et vis la cour pavée d’un hôtel particulier tout de marbre, puis un grand miroir qui faisait tout un pan de mur orné d’or, des gravures de fleurs et de végétation donner un air imposant à cette pièce. On monta un escalier où un tapis dévalait les marches. Puis, arrivés dans une salle, elle me mit à l’aise et m’interrogea :
– Alors, parlez moi de ce fameux colis.
Je lui répondis que je ne l’avais pas ouvert et lui demandai si elle avait connu la famille Kennedy.
– J’avais quatorze ans quand je les ai connus. Mon père était à l’époque le gardien de cet immeuble. Ils venaient de s’installer dans l’immeuble. Tous les dimanches, il s’en allait je ne sais où et me donnait un bonbon en cachette ! Je l’aimais bien, lui aussi. Il disait souvent à mes parents «You have a nice girl ».
Elle prit alors le colis de mes mains, l’examina comme si elle avait le pouvoir de voir à l’intérieur.
– C’est un vrai colis d’époque, sans aucun doute !
Le paquet était plein de poussière, la gardienne souffla dessus, prit un chiffon pour enfin l’ouvrir et découvrir ce qui s’y trouvait. Plutôt petit, c’était quelque chose que chacun possède chez lui, mais celui-ci était unique, sans aucun doute exceptionnel. Un cadre dans lequel on voyait une photo inconnue de tous, mais où figuraient John Kennedy et Marylin Monroe au bord de la mer, sur une plage, tous deux souriants. Les cheveux blonds de Marylin flottaient dans le vent, ils étaient heureux. Une annotation figurait au dos de la photo. Elle semblait avoir été écrite par Marylin et disait : « En souvenir de nos bons moments passés ensemble ». Troublé, je décidai de garder ce colis, arrivé cinquante ans après chez moi, sous cette fenêtre, sur cette table en bois. Je raconterai à mes enfants et mes petits-enfants cette journée qui est gravée à jamais dans ma mémoire.